|
Introduction
Les orages
sont des nuages au sein desquels se produisent des décharges électriques dont
les manifestations visuelles et auditives sont respectivement les éclairs et le
tonnerre. Le nuage caractéristique des orages s'appellent le cumulonimbus. Ce
dernier est reconnaissable par sa grande extension verticale et sa forte
densité.
Les précipitations sont souvent importantes: des averses de
pluie, souvent des chutes de grêle. On observe de puissantes rafales de vent,
quelque fois des
tornades.
Trois
sortes de cumulonimbus
existent :
Ä Le cumulonimbus calvus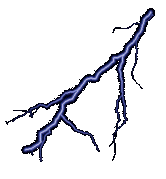
Ä Le cumulonimbus capillatus
incus
Ä le
cumulonimbus avec mamatus
Le plus violents d'entre eux est le capillatus
incus reconnaissable par son sommet en forme d'enclume (incus en latin). Au
stade de maturité, c'est vraiment le roi des nuages.
Mécanismes de formation
Afin de mieux comprendre le
cycle d'un orage, il sera tout d'abord nécessaire d'étudier les différents
processus de formation des nuages.
a) La
condensation
L'air ne peut contenir qu'une
certaine quantité de vapeur d'eau. Cette quantité varie en fonction de la
température: plus l'air est chaud, plus il pourra contenir de vapeur d'eau.
Lorsque la quantité maximale de vapeur d'eau est atteinte, on dit que l'air est
saturé. Au-delà, la vapeur commence à se condenser. La température à
partir de laquelle la vapeur d'eau se condense s'appelle point de
rosée.
b)
Mécanismes ascensionnels
Trois processus existent dont deux
principaux: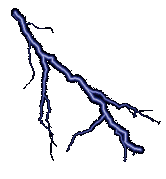
- Le premier est la convection. Quand le sol est chauffé par le soleil, il ré
émet de la chaleur dans l'air au-dessus de lui et crée des poches d'air chaud.
Ces poches d'air s'élèvent et, quand elles atteignent leur point de rosée,
donnent naissance à des
nuages.
-
Le second processus survient quand des fronts atmosphériques se développent.
Quand deux masses de températures différentes se heurtent, l'air plus chaud
passe par-dessus l'air plus froid. Si l'air qui s'élève contient assez
d'humidité, des nuages se forment, différents selon le type de front.
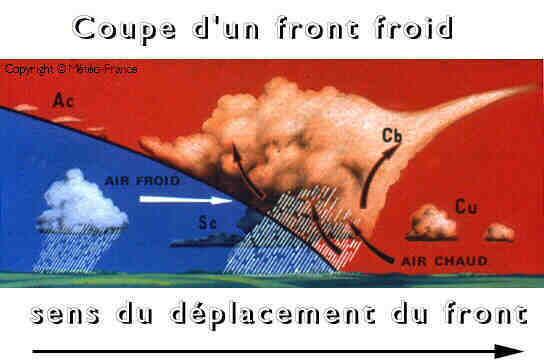
c) Stabilité et
chaleur latente
Une masse d'air continuera à s'élever tant que sa température restera
supérieure à celle de l'air ambiant. Si cette situation persiste alors que l'air
monte, les conditions sont dites instables. En revanche, si la température d'une
masse d'air atteint rapidement celle de l'air ambiant (et cesse donc de
s'élever), les conditions sont dites stables.
 
Cliquez dessus pour avoir la taille
normale
Nota: la
première couche de l'atmosphère s'appelle la troposphère: c'est là que se
produit la plus part des phénomènes météos. La seconde couche s'appelle la
stratosphère, et la limite entre ces deux couches est la
tropopause.
Le cycle d'un orage
Chaque jour, environ 50 000 orages éclatent de par le
monde, le plus souvent dans les régions équatoriales. La puissance d'un orage
peut-être impressionnante quand la pluie, la grêle, les vents violents ou les
tornades
se déchaînent, accompagnés de lueurs éblouissantes des éclairs et du fracas du
tonnerre.
La vie d'un orage se déroule en trois étapes: le développement, la
maturité et la dissipation.
a)
L'amoncellement des nuages
La phase de développement survient quand de l'air
chaud et humide s'élève dans le ciel. A mesure que l'air ascendant refroidit, il
se condense et des nuages se forment. Si la convection est assez forte, les
nuages continuent de se développer jusqu'au stade de cumulus congestus
(congestus: nuage à extension verticale pouvant atteindre une altitude de 4500 à
6000 m).
Pour que le nuage se développe encore, il faut que les étages moyen
et supérieur de la troposphère soient instables. La chaleur latente libérée par
le processus de condensation va accroître l'instabilité en réchauffant l'air
ascendant.
Une fois que le nuage est devenu cumulonimbus, il se développe en
hauteur jusqu'à ce que son sommet atteigne la tropopause, où il s'étale alors et
prend la forme caractéristique d'une enclume.
b) Ciels d'orage
A mesure que
l'air se refroidit au sommet, il s'affaisse aidé par la gravité et les
précipitations, et engendre des courants descendants. Le nuage entre dans son
âge mûr, la phase la plus destructrice d'un orage. Les courants ascendants et
descendants de l'air activent la création de charges électriques opposées, qui
produisent une décharge électrique. Quand l'éclair traverse l'air, sa chaleur
dilate ce dernier et crée une onde acoustique: le tonnerre.
Dès que le nombre
et la force des courants descendants froids augmentent, l'orage entre dans sa
phase dissipative. Les courants descendants répandent un air froid sur le sol,
et ces bourrasques de vent coupent l'alimentation de l'orage en air chaud et
humide, d'où son affaiblissement. Selon le type d'orage, son cycle complet dure
de 15 minutes à plusieurs heures.
c) Les types
d'orages
Les orages convectifs sont dus à la
seule convection d'une masse d'air chaud et ne sont pas alors associés à un
front de perturbation. Un tel orage peut-être
multicellulaire.
Les
orages associés à front froid de perturbation forment une ligne appelée ligne de
grains. Ces orages sont alimentés par le front et ont en abondance humidité,
mouvements ascensionnels et instabilité. Parfois il se forme des orages
auto-entretenus très violents à l'extrémité d'une ligne de grains. Appelés
orages
supercellulaires,
ils peuvent durer plusieurs heures, car le front froid leur fournit un flux
continu d'air plus froid à moyenne altitude qui augmente l'instabilité
atmosphérique. Ils engendrent les vents, les averses de grêle et les
tornades les plus destructeurs. |